Par Adrien Minard
Pour la moitié environ, il ne fait guère de doute qu’un remède existe, mais qu’il est délibérément caché aux populations pauvres. L’idée que le VIH serait un virus produit par l’homme obtient une proportion similaire d’approbations. Les enquêteurs ont par ailleurs établi une corrélation négative entre l’adhésion à ces théories du complot et l’usage du préservatif chez les hommes noirs, et en ont conclu que ces croyances constituent un obstacle majeur aux campagnes de prévention (Bogart & Thorburn, 2005). Par ailleurs, ils ont montré que de telles croyances sont plus ancrées chez les personnes affirmant une forte identification à la communauté noire, ce qui semble indiquer qu’elles sont positivement corrélées à un savoir collectif sur la culture et l’histoire des Noirs et des discriminations aux Etats-Unis. Les autres variables socio-démographiques n’ont pas d’effets significatifs sur le public étudié, ce qui veut dire que les théories du complot à propos du sida ne dépendent ni du revenu, ni du niveau d’éducation, mais concernent de larges segments de la population noire, tous profils confondus (Bogart & Thorburn, 2006). Plutôt que de déconsidérer cette crédulité et de l’assimiler à des comportements irrationnels ou pathologiques, certains éducateurs et professionnels de la santé, soucieux d’améliorer l’efficience des programmes de prévention existants, ont affirmé la nécessité de prendre au sérieux ces discours afin d’en expliciter les conditions de possibilité et les déterminants socio-historiques (Thomas & Quinn, 1991).
De fait, les inégalités sanitaires et sociales dont la population noire des Etats-Unis est victime ont constitué un terreau favorable au développement de ces théories du complot. La prévalence du sida parmi les Noirs Américains est sans commune mesure avec celle observée dans les autres populations du pays. Cette surreprésentation s’ajoute au fait que les revendications d’égalité portées par le mouvement des droits civiques à partir des années 1950 semblent avoir échoué, puisqu’ils sont encore nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté. Le ressentiment lié à la conscience d’appartenir à une communauté défavorisée, de même que la peur suscitée par la vitesse de la contagion, jouent un rôle non négligeable dans la réception des thèses conspirationnistes, mais n’en éclairent pas pleinement la genèse. Pour comprendre leur succès, ainsi que leur contenu, il faut revenir sur les controverses qui ont suivi la découverte du sida.
L’idée que le sida serait l’instrument privilégié d’un génocide planifié de la population noire a été relayée par d’importants journaux et magazines communautaires, comme le Los Angeles Sentinel ou Essence, dès la fin des années 1980. Ce thème de l’« Holocauste noir » apparaît alors aussi dans les premières enquêtes informelles menées dès 1990 par la Conférence des chrétiens dirigeants du Sud (SCLC), une organisation pour les droits civiques fondée par Martin Luther King. Il s’agit alors cependant d’un lexique exogène, qui était répandu dans le discours de certaines associations homosexuelles et dans les prises de position de scientifiques dissidents contestant la thèse dominante de l’origine virale du sida (Jones, 1993).
Ce discours s’est construit en réaction aux récriminations moralistes adressées à la communauté homosexuelle, où l’on dénombrait la plus grande quantité de malades durant les premières années de l’épidémie. La mise en cause du mode de vie, de l’activité sexuelle ou de l’absence de responsabilité individuelle des gays dans son développement était fréquente dans les déclarations des représentants de la Nouvelle Droite américaine et de certains scientifiques. Elle réactualisait ainsi l’appréhension de la maladie sexuellement transmissible en termes de châtiment destiné à punir l’immoralité et la débauche, qui était déjà répandue au début du siècle à propos de la syphilis (Brandt, 1987). La référence à un projet d’extermination des homosexuels visait dès lors à renverser l’accusation et constituait une arme discursive couramment opposée aux diatribes homophobes de l’époque. L’amalgame historique dont elle est porteuse, par référence implicite à la Shoah, découlait probablement aussi d’une quête d’identité collective similaire à celle qui a été observée dans le cas de l’association Act up en France (Pinell, 2002). Cette rhétorique traduisait également l’intérêt d’une partie de la communauté gay, parallèlement à l’activisme associatif, pour les théories hétérédoxes sur le sida. Les découvertes de Robert Gallo et de Luc Montagnier (1983-1984) ont érigé la définition virale du sida en thèse dominante parmi les experts, mais l’incapacité des chercheurs à en préciser les origines a suscité une longue controverse au cours de laquelle des scientifiques dissidents, bien que minoritaires, ont mis à profit les échecs thérapeutiques pour faire valoir des théories alternatives, auxquelles ils assurèrent un écho en les propulsant dans l’arène médiatique, où les outrances langagières ont davantage droit de cité que dans les grands colloques de l’establishment médical (Epstein, 2001). Dans ce contexte marqué à la fois par le désespoir de nombreux gays et la vigueur de la polémique, les théories du complot ont pu se développer. Elles trouvèrent un partisan actif en la personne du docteur Alan Cantwell, un dermatologue de Los Angeles, qui affirma que le sida avait été introduit aux Etats-Unis dans le cadre d’un programme de test d’un vaccin contre l’hépatite B. Dans son livre intitulé AIDS and the Doctors of Death, il prétendait que le groupe soumis à l’expérience, composé de quelques 500 homosexuels new-yorkais, avait reçu un vaccin délibérément contaminé par le sida, suggérant que le virus était une arme de guerre biologique destinée à éradiquer la communauté homosexuelle américaine (Cantwell, 1988). Le retentissement de ses thèses, couplé à celui d’autres voix prétendant que le VIH n’est pas la cause du sida ou que les traitements fondés sur l’AZT sont hautement toxiques, a contribué à diffuser la croyance en un plan génocidaire parmi certaines franges activistes de la communauté homosexuelle.
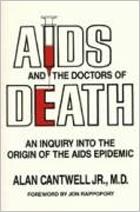
Lorsque, à la fin des années 1980, une seconde vague de contaminations affecta cette fois les populations noires des centres-villes, où l’épidémie, aggravée par la toxicomanie, toucha des familles entières, la même suspicion se porta, par un phénomène de transfert d’une minorité à l’autre, sur la communauté afro-américaine. La condamnation morale du comportement des consommateurs de drogues et des femmes noires donnant naissance à des enfants contaminés alimenta, comme dans le cas des gays, un contre-discours de nature conspirationniste. Cependant, sa réception fut beaucoup plus massive, et dépassa largement les cercles militants engagés dans les controverses liées au sida. C’est l’ampleur de cette diffusion qu’il s’agit d’expliquer.
L’extrême sensibilité du public noir américain à la rhétorique complotiste trouve ses racines dans une mémoire collective marquée par une histoire longue des discriminations et, particulièrement, par un épisode traumatique dont les conséquences ont été parfois sous-estimées : il est connu sous le nom d’« étude de Tuskegee sur la syphilis ». En 1990, des médecins et des inspecteurs de la santé publique exerçant dans les communautés noires ont témoigné devant la Commission nationale sur le sida du poids de ce souvenir dans la défiance entretenue par de nombreux Noirs à l’encontre des autorités sanitaires, ce que de nombreux professionnels ont par la suite confirmé (Thomas & Quinn, 1991 ; Reverby, 2000). L’historien James Jones a reconstitué dans le détail le récit de cette expérimentation humaine à but non thérapeutique - la plus longue de l’histoire de la médecine, puisqu’elle a duré quarante ans (1932-1972). Il a montré comment un projet initial de dépistage et de traitement de la syphilis dans la population noire travaillant dans les plantations de plusieurs comtés du sud des Etats-Unis s’est transformée en expérience utilisant des centaines de cobayes humains pour compléter certaines connaissances médicales sur l’évolution de la syphilis non traitée (Jones, 1993 ; Reverby, 2009). Lorsque la Grande Dépression de 1929 a raréfié les ressources financières disponibles, le Service de santé publique (PHS) décida de réorienter son programme de traitement, devenu trop coûteux, vers une étude scientifique devant permettre de trancher la question des différences raciales concernant le développement de la maladie. Il s’agissait alors de savoir si la syphilis avait un impact spécifique sur le système cardio-vasculaire des Noirs. Pour ce faire, plus de 400 individus de la région de Tuskegee, dans l’Alabama, qui avaient été dépistés comme syphilitiques, ont été suivis et régulièrement examinés durant toute la progression de la maladie sans qu’aucun traitement ne leur soit administré, y compris quand, à partir de 1943, l’usage de la pénicilline se diffusa dans le pays. Les stratégies déployées par le Service de santé publique consistaient à s’adapter de manière optimale au milieu culturel dans lequel l’étude était menée, en obtenant par exemple la collaboration active de médecins, d’infirmières ou de pasteurs membres de la communauté noire, comme de propriétaires de plantations, afin de faciliter le recrutement et le suivi des malades. Les écoles et les églises locales ont été utilisées pour procéder aux examens corporels et aux prélèvements sanguins sur les patients. Ces derniers, quant à eux, étaient maintenus dans l’ignorance du mal dont ils souffraient et de ses modes de transmission. Les cliniciens du PHS ont acclimaté les termes médicaux au langage local, la syphilis devenant le « mauvais sang » - une formule utilisée par les Noirs du sud pour désigner des maux divers. Des avantages matériels et financiers ont été distribués pour obtenir le « consentement » des sujets et les frais d’obsèques ont été pris en charge pour obtenir des familles la permission de procéder à des autopsies post-mortem sur les individus ayant atteint le « stade terminal ». Lorsque, le 25 juillet 1972, le Washington Star publia un récit de l’expérience, cette révélation eut un écho considérable dans l’opinion, notamment dans la population afro-américaine. Des auditions furent organisées par une commission du Congrès, des dédommagements importants ont été débloqués, de nouvelles règles éthiques en matière d’expérimentation humaine édictées. En 1997, le président Clinton prononça des excuses officielles au cours d’une cérémonie en présence de quelques survivants. Le bilan de l’étude de Tuskegee n’en a pas moins été catastrophique pour les victimes, la plupart étant décédées de la syphilis ou de ses conséquences avant son interruption, mais aussi pour l’image et la crédibilité des autorités sanitaires américaines. Plus encore que les inégalités sanitaires et sociales, c’est la rémanence de ce passé douloureux qui explique l’ampleur de la réception des théories du complot parmi les Noirs américains.
L’étude de l’émergence et de la circulation de ces croyances n’est ici qu’à peine esquissée. Elle mériterait des investigations beaucoup plus poussées, comme cela a été fait en ce qui concerne l’Afrique du Sud (Fassin, 2006). Elle montre néanmoins que ces croyances relèvent moins d’une vogue de l’irrationnel ou de manipulations de propagandistes mal intentionnés que d’un savoir collectif souvent marqué par le vécu de situations d’extrême discrimination. La prise en compte de ces expériences bien réelles est nécessaire pour comprendre l’adhésion à ces théories fallacieuses qui, bien qu’erronées, doivent être considérées comme une forme de mise en récit, par une communauté, de son propre destin.
Ouvrages cités :
L'auteur : Adrien Minard est diplômé de l'IEP de Paris et professeur agrégé d'histoire dans l'enseignement secondaire. Il est l'auteur, avec Michaël Prazan, de Roger Garaudy. Itinéraire d'une négation (Calmann-Lévy, 2007).
Voir aussi :
Par Adrien Minard
Pour la moitié environ, il ne fait guère de doute qu’un remède existe, mais qu’il est délibérément caché aux populations pauvres. L’idée que le VIH serait un virus produit par l’homme obtient une proportion similaire d’approbations. Les enquêteurs ont par ailleurs établi une corrélation négative entre l’adhésion à ces théories du complot et l’usage du préservatif chez les hommes noirs, et en ont conclu que ces croyances constituent un obstacle majeur aux campagnes de prévention (Bogart & Thorburn, 2005). Par ailleurs, ils ont montré que de telles croyances sont plus ancrées chez les personnes affirmant une forte identification à la communauté noire, ce qui semble indiquer qu’elles sont positivement corrélées à un savoir collectif sur la culture et l’histoire des Noirs et des discriminations aux Etats-Unis. Les autres variables socio-démographiques n’ont pas d’effets significatifs sur le public étudié, ce qui veut dire que les théories du complot à propos du sida ne dépendent ni du revenu, ni du niveau d’éducation, mais concernent de larges segments de la population noire, tous profils confondus (Bogart & Thorburn, 2006). Plutôt que de déconsidérer cette crédulité et de l’assimiler à des comportements irrationnels ou pathologiques, certains éducateurs et professionnels de la santé, soucieux d’améliorer l’efficience des programmes de prévention existants, ont affirmé la nécessité de prendre au sérieux ces discours afin d’en expliciter les conditions de possibilité et les déterminants socio-historiques (Thomas & Quinn, 1991).
De fait, les inégalités sanitaires et sociales dont la population noire des Etats-Unis est victime ont constitué un terreau favorable au développement de ces théories du complot. La prévalence du sida parmi les Noirs Américains est sans commune mesure avec celle observée dans les autres populations du pays. Cette surreprésentation s’ajoute au fait que les revendications d’égalité portées par le mouvement des droits civiques à partir des années 1950 semblent avoir échoué, puisqu’ils sont encore nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté. Le ressentiment lié à la conscience d’appartenir à une communauté défavorisée, de même que la peur suscitée par la vitesse de la contagion, jouent un rôle non négligeable dans la réception des thèses conspirationnistes, mais n’en éclairent pas pleinement la genèse. Pour comprendre leur succès, ainsi que leur contenu, il faut revenir sur les controverses qui ont suivi la découverte du sida.
L’idée que le sida serait l’instrument privilégié d’un génocide planifié de la population noire a été relayée par d’importants journaux et magazines communautaires, comme le Los Angeles Sentinel ou Essence, dès la fin des années 1980. Ce thème de l’« Holocauste noir » apparaît alors aussi dans les premières enquêtes informelles menées dès 1990 par la Conférence des chrétiens dirigeants du Sud (SCLC), une organisation pour les droits civiques fondée par Martin Luther King. Il s’agit alors cependant d’un lexique exogène, qui était répandu dans le discours de certaines associations homosexuelles et dans les prises de position de scientifiques dissidents contestant la thèse dominante de l’origine virale du sida (Jones, 1993).
Ce discours s’est construit en réaction aux récriminations moralistes adressées à la communauté homosexuelle, où l’on dénombrait la plus grande quantité de malades durant les premières années de l’épidémie. La mise en cause du mode de vie, de l’activité sexuelle ou de l’absence de responsabilité individuelle des gays dans son développement était fréquente dans les déclarations des représentants de la Nouvelle Droite américaine et de certains scientifiques. Elle réactualisait ainsi l’appréhension de la maladie sexuellement transmissible en termes de châtiment destiné à punir l’immoralité et la débauche, qui était déjà répandue au début du siècle à propos de la syphilis (Brandt, 1987). La référence à un projet d’extermination des homosexuels visait dès lors à renverser l’accusation et constituait une arme discursive couramment opposée aux diatribes homophobes de l’époque. L’amalgame historique dont elle est porteuse, par référence implicite à la Shoah, découlait probablement aussi d’une quête d’identité collective similaire à celle qui a été observée dans le cas de l’association Act up en France (Pinell, 2002). Cette rhétorique traduisait également l’intérêt d’une partie de la communauté gay, parallèlement à l’activisme associatif, pour les théories hétérédoxes sur le sida. Les découvertes de Robert Gallo et de Luc Montagnier (1983-1984) ont érigé la définition virale du sida en thèse dominante parmi les experts, mais l’incapacité des chercheurs à en préciser les origines a suscité une longue controverse au cours de laquelle des scientifiques dissidents, bien que minoritaires, ont mis à profit les échecs thérapeutiques pour faire valoir des théories alternatives, auxquelles ils assurèrent un écho en les propulsant dans l’arène médiatique, où les outrances langagières ont davantage droit de cité que dans les grands colloques de l’establishment médical (Epstein, 2001). Dans ce contexte marqué à la fois par le désespoir de nombreux gays et la vigueur de la polémique, les théories du complot ont pu se développer. Elles trouvèrent un partisan actif en la personne du docteur Alan Cantwell, un dermatologue de Los Angeles, qui affirma que le sida avait été introduit aux Etats-Unis dans le cadre d’un programme de test d’un vaccin contre l’hépatite B. Dans son livre intitulé AIDS and the Doctors of Death, il prétendait que le groupe soumis à l’expérience, composé de quelques 500 homosexuels new-yorkais, avait reçu un vaccin délibérément contaminé par le sida, suggérant que le virus était une arme de guerre biologique destinée à éradiquer la communauté homosexuelle américaine (Cantwell, 1988). Le retentissement de ses thèses, couplé à celui d’autres voix prétendant que le VIH n’est pas la cause du sida ou que les traitements fondés sur l’AZT sont hautement toxiques, a contribué à diffuser la croyance en un plan génocidaire parmi certaines franges activistes de la communauté homosexuelle.
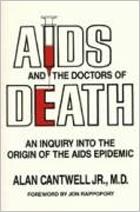
Lorsque, à la fin des années 1980, une seconde vague de contaminations affecta cette fois les populations noires des centres-villes, où l’épidémie, aggravée par la toxicomanie, toucha des familles entières, la même suspicion se porta, par un phénomène de transfert d’une minorité à l’autre, sur la communauté afro-américaine. La condamnation morale du comportement des consommateurs de drogues et des femmes noires donnant naissance à des enfants contaminés alimenta, comme dans le cas des gays, un contre-discours de nature conspirationniste. Cependant, sa réception fut beaucoup plus massive, et dépassa largement les cercles militants engagés dans les controverses liées au sida. C’est l’ampleur de cette diffusion qu’il s’agit d’expliquer.
L’extrême sensibilité du public noir américain à la rhétorique complotiste trouve ses racines dans une mémoire collective marquée par une histoire longue des discriminations et, particulièrement, par un épisode traumatique dont les conséquences ont été parfois sous-estimées : il est connu sous le nom d’« étude de Tuskegee sur la syphilis ». En 1990, des médecins et des inspecteurs de la santé publique exerçant dans les communautés noires ont témoigné devant la Commission nationale sur le sida du poids de ce souvenir dans la défiance entretenue par de nombreux Noirs à l’encontre des autorités sanitaires, ce que de nombreux professionnels ont par la suite confirmé (Thomas & Quinn, 1991 ; Reverby, 2000). L’historien James Jones a reconstitué dans le détail le récit de cette expérimentation humaine à but non thérapeutique - la plus longue de l’histoire de la médecine, puisqu’elle a duré quarante ans (1932-1972). Il a montré comment un projet initial de dépistage et de traitement de la syphilis dans la population noire travaillant dans les plantations de plusieurs comtés du sud des Etats-Unis s’est transformée en expérience utilisant des centaines de cobayes humains pour compléter certaines connaissances médicales sur l’évolution de la syphilis non traitée (Jones, 1993 ; Reverby, 2009). Lorsque la Grande Dépression de 1929 a raréfié les ressources financières disponibles, le Service de santé publique (PHS) décida de réorienter son programme de traitement, devenu trop coûteux, vers une étude scientifique devant permettre de trancher la question des différences raciales concernant le développement de la maladie. Il s’agissait alors de savoir si la syphilis avait un impact spécifique sur le système cardio-vasculaire des Noirs. Pour ce faire, plus de 400 individus de la région de Tuskegee, dans l’Alabama, qui avaient été dépistés comme syphilitiques, ont été suivis et régulièrement examinés durant toute la progression de la maladie sans qu’aucun traitement ne leur soit administré, y compris quand, à partir de 1943, l’usage de la pénicilline se diffusa dans le pays. Les stratégies déployées par le Service de santé publique consistaient à s’adapter de manière optimale au milieu culturel dans lequel l’étude était menée, en obtenant par exemple la collaboration active de médecins, d’infirmières ou de pasteurs membres de la communauté noire, comme de propriétaires de plantations, afin de faciliter le recrutement et le suivi des malades. Les écoles et les églises locales ont été utilisées pour procéder aux examens corporels et aux prélèvements sanguins sur les patients. Ces derniers, quant à eux, étaient maintenus dans l’ignorance du mal dont ils souffraient et de ses modes de transmission. Les cliniciens du PHS ont acclimaté les termes médicaux au langage local, la syphilis devenant le « mauvais sang » - une formule utilisée par les Noirs du sud pour désigner des maux divers. Des avantages matériels et financiers ont été distribués pour obtenir le « consentement » des sujets et les frais d’obsèques ont été pris en charge pour obtenir des familles la permission de procéder à des autopsies post-mortem sur les individus ayant atteint le « stade terminal ». Lorsque, le 25 juillet 1972, le Washington Star publia un récit de l’expérience, cette révélation eut un écho considérable dans l’opinion, notamment dans la population afro-américaine. Des auditions furent organisées par une commission du Congrès, des dédommagements importants ont été débloqués, de nouvelles règles éthiques en matière d’expérimentation humaine édictées. En 1997, le président Clinton prononça des excuses officielles au cours d’une cérémonie en présence de quelques survivants. Le bilan de l’étude de Tuskegee n’en a pas moins été catastrophique pour les victimes, la plupart étant décédées de la syphilis ou de ses conséquences avant son interruption, mais aussi pour l’image et la crédibilité des autorités sanitaires américaines. Plus encore que les inégalités sanitaires et sociales, c’est la rémanence de ce passé douloureux qui explique l’ampleur de la réception des théories du complot parmi les Noirs américains.
L’étude de l’émergence et de la circulation de ces croyances n’est ici qu’à peine esquissée. Elle mériterait des investigations beaucoup plus poussées, comme cela a été fait en ce qui concerne l’Afrique du Sud (Fassin, 2006). Elle montre néanmoins que ces croyances relèvent moins d’une vogue de l’irrationnel ou de manipulations de propagandistes mal intentionnés que d’un savoir collectif souvent marqué par le vécu de situations d’extrême discrimination. La prise en compte de ces expériences bien réelles est nécessaire pour comprendre l’adhésion à ces théories fallacieuses qui, bien qu’erronées, doivent être considérées comme une forme de mise en récit, par une communauté, de son propre destin.
Ouvrages cités :
L'auteur : Adrien Minard est diplômé de l'IEP de Paris et professeur agrégé d'histoire dans l'enseignement secondaire. Il est l'auteur, avec Michaël Prazan, de Roger Garaudy. Itinéraire d'une négation (Calmann-Lévy, 2007).
Voir aussi :
Depuis dix-sept ans, Conspiracy Watch contribue à sensibiliser aux dangers du complotisme en assurant un travail d’information et de veille critique sans équivalent. Pour pérenniser nos activités, le soutien de nos lecteurs est indispensable.