Pour Céline Masson et Isabelle de Mecquenem, l’antisémitisme n’a jamais disparu. Ses mutations passées et présentes tiendraient à sa perpétuation sous une forme latente dans les strates les plus profondes de notre société.

Le pathos antisémite ou judéopathie qui s’exprime de façon virale sur les réseaux sociaux comme nous l’observons en ces temps de pandémie que nous nommons pandémon (le peuple « demos » face à ses « démons »), évoque une forme de violence qui nous dépasse. Comme dit René Girard, la violence est mimétique et tend à se propager dans le « corps social » tout entier. Le flot de messages de haine véhiculés par les réseaux sociaux fait preuve d’une redoutable efficacité, frappant les internautes par des montages « spectaculaires » – l’image y joue un rôle déterminant par la fascination et la sidération qu’elle induit. A l’heure où nous écrivons, le journal israélien Haaretz révèle que Cindy Goldberg[1], présidente du conseil d’administration d’une école aux États-Unis, d’origine juive, a été la cible d’un piratage informatique antisémite sur Zoom[2] mardi soir 21 avril 2020. Des antisémites probablement négationnistes qui ont le flair onomastique, ont posté aux parents et aux membres du conseil d’administration des extraits de dessins animés figurant Hitler, des images de soldats nazis, des croix gammées ainsi que des images pornographiques. Des menaces ont également été adressées aux familles.
Par ailleurs, et alors que plusieurs pays commémorent le « Yom HaShoah » (jour dédié au souvenir du génocide des Juifs assassinés lors de la seconde guerre mondiale[3]), une réunion organisée en visioconférence via Zoom lundi 20 avril par l’ambassade d’Israël à Berlin, a été perturbée par des militants antisémites et pro-palestiniens qui ont intercepté le discours d’un survivant de la Shoah, Zvi Herschel, en postant des photos d’Hitler, des images pornographiques et en proférant des slogans agressifs. L'information a été rendue publique par l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Jeremy Issacharoff :
After a short break the event was reconvened without the activists and conducted in an appropriate and respectful way. To dishonour the memory of the #Holocaust and the dignity of the survivor is beyond shame and disgrace and shows the blatant antisemitic nature of the activists. pic.twitter.com/t79gXPYkIO
— Jeremy Issacharoff (@JIssacharoff) April 21, 2020
Ces incidents corroborent ce que nous observons depuis plusieurs années à savoir des formes bruyantes et parfois meurtrières d’antisémitisme dans le monde et notamment dans notre pays[4].
Les commémorations nous font réfléchir aux dilemmes de l’Histoire et de la mémoire, ainsi qu’au rôle des témoins dans la transmission. C’est aux rescapés hagards et silencieux, qui avaient compris qu’ils ne seraient pas compris, que ceux qui témoignent aujourd’hui redonnent une voix. Mais l’enseignement de l’histoire est en principe indépendant de la présence des témoins et mobilise les outils de la rationalité critique. L’éducation civique a elle-même été changée en un enseignement moral et civique. Le Procès de Nuremberg, la création de la notion de « crime contre l’humanité », la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le procès Eichmann ont marqué des tournants décisifs d’une prise de conscience qui commence à l’École. Le slogan « Plus jamais ça ! » repris pour dénoncer le racisme a fini par s’user et son paradoxe est de révéler l’épuisement des pédagogies antiracistes moralisatrices. La condamnation ne peut faire l’économie de la réflexion.
La « culpabilité allemande » a été invoquée par le Président fédéral allemand dans son discours à Jérusalem en janvier dernier lors de la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz, mettant ainsi de côté les analyses qui ont discuté l’idée d’une responsabilité et d’une culpabilité collectives. Ainsi, le philosophe et psychiatre Karl Jaspers, dès 1946, pensait que celui qui est resté passif devant le crime est moralement coupable car il y a toujours du « jeu » pour être actif lorsqu’on est témoin du « malheur même qui frappe la vue »[5].
Les éducateurs et les politiques ont un point en commun : ils recherchent constamment des méthodes et des discours efficaces, mais ils se heurtent à la rémanence de l’antisémitisme, celui-ci ne connaissant que des fluctuations. En effet, l’antisémitisme n’a jamais disparu, il s’est diversifié dans ses sources et justifications idéologiques, s’est métamorphosé au contact des nouveaux médias et des réseaux sociaux. À l’heure où nos institutions soulèvent la question lancinante de la transmission de la mémoire et de l’histoire de la Shoah, ne faut-il pas d’abord s’interroger sur la transmissibilité de l’antisémitisme ? Pourquoi et comment l’antisémitisme se perpétue-t-il d’une génération à l’autre ?
Nous formulons l’hypothèse que cette transmission tient à une forme latente d’antisémitisme présente dans les strates les plus profondes de notre société. Par ailleurs, cette transmissibilité s’observe au sein même d’une certaine jeunesse qui se forge une connivence de groupe et une contre-culture par le rire antisémite comme signe de reconnaissance.
Une enquête réalisée par la Fondapol et publiée en janvier 2020 révèle que l’antisémitisme est un phénomène perçu par les Français de confession ou de culture juive et par le grand public comme étant important et en augmentation. Selon cette étude, 70% de ces Français juifs déclarent avoir été victimes d’au moins un acte antisémite au cours de leur vie.
Ce climat suscite dans la communauté juive un fort sentiment de crainte, voire de peur, qui a pour conséquence des comportements de méfiance et de repli interprétés comme du communautarisme intempestif.
Ainsi, telle étudiante juive résidant à Sarcelles, décrit son quotidien. Afin de se rendre à la synagogue en face de chez elle et se soustraire aux regards, elle évite la rue et fait un détour par un grand terrain vague où elle est sûre de ne croiser personne. Tel autre étudiant de la même ville évoque même le « ghetto obligé » pour se soutenir mutuellement. Telle autre personne encore explique : « À mes enfants, je demande de n’avoir aucun signe extérieur religieux. J’ai trop peur qu’ils se fassent agresser, c’est une vraie angoisse. Vivons bien, vivons "casher" comme on dit ! […] On se sent en danger, on a l’impression que l’on veut nous effacer. Donc il y a une réaction en chaîne et on se cache nous-mêmes. » Des Juifs de France ont peur et se posent avec acuité, mais non sans perplexité, la question d’un départ définitif. N’est-ce pas symptomatique d’un malaise profond de notre démocratie ?
Telle est la réalité quotidienne de certaines familles juives en France. Comment dès lors remédier à ce qui ressemble à une purge massive de nos concitoyens juifs ?
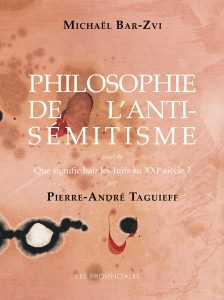
Les symptômes de ce fléau s’observent également sur les murs de la ville, ses portes, ses façades, la « partie commune » de la ville : « Le graffiti devient le complice d’un antisémitisme universel, "partie commune" de la société, quelque chose qui vient d’en bas, du peuple en dessous »[6] . Comme une « blessure irréparable » écrit le philosophe Michaël Bar-Zvi, qui s’expose à hauteur de vue du passant pressé dans la ville, indifférent à la violence rampante qui frappe le corps social malade de ses Juifs.
Le 26 novembre 2019[7], un tag est découvert sur les murs de l’Université Panthéon-Assas qui désigne deux cibles anthropologiques : « à bas le patriarcat » devient « à bas la juiverie » par glissement sémantique et dégradation de la figure d’autorité en une figure d’altérité phobogène.
Ce tag, véritable figure de condensation, au même titre que les rêves, donc surdéterminée et polysémique, greffe un slogan néo-féministe radical inspiré de mai 68 sur une expression de l’inextinguible antisémitisme. « Juiverie » nous renvoie en effet à Édouard Drumont (La France juive) et à l’Affaire Dreyfus, mais aussi au complotisme de l’extrême-droite actuelle. Comme si nous assistions aujourd’hui à la coalescence d’idéologies antagonistes, alors qu’en 68 « à bas le patriarcat ! » aurait plutôt été ponctué par « nous sommes tous des juifs allemands ».
Cette concrétion sémantique, véritable symptôme mural, peut nous porter à une analyse de ce tag surexposé et là encore Bar-Zvi nous éclaire lorsqu’il convoque les représentations de l’antisémite et ce qu’il relève de « l’ethnie putain ». Il cite Alexander Berg : « Toutes le affaires de prostitution et de traite des blanches sont presque exclusivement entre les mains des Juifs »[8] Le mythe, dit Bar-Zvi, associe deux aspects de la prostitution, l’asservissement de la femme et l’« esprit putain ». Dès lors, peut-on faire accroire que ce tag augmenté est une pure coïncidence ?
Il est intéressant de saisir à la racine le sens de ce symptôme. Le patriarcat se rapporte au mythe du père de la horde primitive, jaloux et violent qui garde les femmes et évince les fils et qui se résout par le meurtre du père par les frères expulsés qui le consomment. C’est la thèse de Freud dans Totem et tabou[9] qui stipule que les fils mirent ainsi un terme à la horde paternelle et que de cette manière les choses prirent leur commencement comme les restrictions morales, les organisations sociales et la religion. Après le meurtre, les fils éprouvent regrets et remords, abjurent leurs erreurs et inventent un nouvel ordre social[10]. Ce meurtre ne peut être pensé qu’à la condition où les fils reconnaissent l’image du père et instaurent l’abolition du crime, ce qui suppose l’intériorisation symbolique du meurtre et de sa fonction. Le Juif est la dégradation de ce père castrateur, sa face monstrueuse et perfide, le xenos dit Bar-Zvi, l’étranger qui pervertit le demos, le peuple, en prostituant ses femmes. C’est le père de la horde, bestial dont la soif de pouvoir est inextinguible, et fait échec à la volonté des fils. Le nom même de « juif » est synonyme d’« obscénité ». Ce xenos inquiétant et étranger, qui brave tous les interdits mais en même temps si proche et si familier que cela en devient insupportable, ne relèverait-il pas de la part fantasmatique propre à chacun ? D’où le caractère irrépressible et insurmontable de l’antisémitisme.
Il y a donc toujours des insultes, des graffitis, des menaces ou des rumeurs malveillantes visant « les Juifs ».
À travers ces exemples qui surgissent dans des contextes différents, nous voyons que nous ne sommes plus seulement confrontés à la concurrence des mémoires et au négationnisme, mais aussi, dans les formes les plus récentes et chez les plus jeunes rompus au partage immédiat, à une vulgate antisémite dépolitisée et anhistorique, à peine consciente, encore moins réfléchie. Un antisémitisme sans antisémites, certes, mais un antisémitisme socialisé par le relais des écrans.
Aussi la question des médias doit-elle être appréhendée non seulement sous l’angle des limites et de la réglementation de la liberté d’expression, mais aussi comme le lieu du défi que pose une communauté virtuelle soudée par la transgression jubilatoire de la culture scolaire, académique et de toute culture considérée comme « officielle » en général. Ce qui pose le problème des idéaux que nous pouvons offrir aux nouveaux venus, et donc, de notre capacité à en proposer.
Notes :
[1] Elle est membre d’une synagogue libérale et l'un de ses trois enfants porte une kippa. Après l'incident de mardi, elle a déclaré qu'elle voulait qu'il porte une casquette afin de cacher sa kippa lorsqu’il se promenait dans la rue.
[2] Zoom est un service de téléconférences permettant d’impliquer un grand nombre de participants.
[3] La commémoration se tient généralement le 27 du mois hébraïque de Nissan (entre le début du mois d’avril et celui de mai selon les années) dans le calendrier hébraïque. Cette année elle s’est tenue du lundi 20 avril au soir jusqu’au mardi 21 à 18 heures.
[4] Les chiffres publiés le 27 janvier par le ministère de l’Intérieur indiquent une augmentation de 50% des menaces en 2019 par rapport à 2018 mais une baisse de 15% des actions antisémites en France. Voir également : « Sondage : un Européen sur quatre reconnaît nourrir de l’hostilité à l’égard des Juifs » (29 novembre 2019).
[5] K. Jaspers, La Culpabilité allemande, Editions de Minuit, Paris, 1990.
[6] M. Bar-Zvi, Philosophie de l’antisémitisme, Les Provinciales, Paris, 2019, p. 15.
[7] Remerciements à l’UEJF et Noémie Madar qui nous a communiqué cette photo. Suite à leur action, le tag a été effacé.
[8] Ibid., p.106. Il reprend cette citation du livre antisémite d'Alexander Berg, Juden-Bordelle, Enthüllungen aus dunklen Häusern, 1892 (Les bordels juifs. Révélations sur les maisons closes), tirée du livre de Saul Friedländer. Alexander Berg était un médecin allemand. Une notice de la BNF témoigne de la publication d'ouvrages médicaux et de son titre de docteur.
[9] S. Freud, Totem et tabou. Quelques concordances entre la vie des sauvages et celle des névrosés (1913), Paris, Gallimard, 1993.
[10] Cf. E. Roudinesco, « Freud et le régicide. Eléments d’une réflexion », Revue germanique internationale, 14/2000, p. 113-126. Elle écrit notamment : « Il y aurait donc à l’origine de toute religion et de toute société un acte réel qui ferait événement : un meurtre, un meurtre nécessaire. [...] En conséquence, l’acte réel disparaît au profit de l’acte symbolique. Le meurtre du père devient ainsi une métaphore de la castration et non plus exactement un crime. À cet égard, il y a bien une différence entre Totem et tabou et L’Homme Moïse : dans le premier ouvrage, Freud pose l’existence d’un acte réel, tandis que dans le second, il reconstruit l’origine supposée d’un acte dont nul n’a besoin de savoir s’il a réellement eu lieu, puisque seule compte sa puissance symbolique. »
Les auteurs : Céline Masson est directrice du Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA), Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (CHSSC), Université de Picardie Jules-Verne. Isabelle de Mecquenem est directrice adjointe du RRA, professeure agrégée en INSPE, Université de Reims-Champagne-Ardenne, membre du Conseil des sages de la laïcité. Toutes deux dirigent la collection « Questions sensibles » chez Hermann dont le premier livre, Criminaliser les Juifs de Pierre-André Taguieff, est paru début 2020.
Voir aussi :
La Pologne et la Russie s'accusent mutuellement de falsifier l'histoire
Taguieff : « Une démonologie populaire se forme sous nos yeux sur les réseaux sociaux »

Le pathos antisémite ou judéopathie qui s’exprime de façon virale sur les réseaux sociaux comme nous l’observons en ces temps de pandémie que nous nommons pandémon (le peuple « demos » face à ses « démons »), évoque une forme de violence qui nous dépasse. Comme dit René Girard, la violence est mimétique et tend à se propager dans le « corps social » tout entier. Le flot de messages de haine véhiculés par les réseaux sociaux fait preuve d’une redoutable efficacité, frappant les internautes par des montages « spectaculaires » – l’image y joue un rôle déterminant par la fascination et la sidération qu’elle induit. A l’heure où nous écrivons, le journal israélien Haaretz révèle que Cindy Goldberg[1], présidente du conseil d’administration d’une école aux États-Unis, d’origine juive, a été la cible d’un piratage informatique antisémite sur Zoom[2] mardi soir 21 avril 2020. Des antisémites probablement négationnistes qui ont le flair onomastique, ont posté aux parents et aux membres du conseil d’administration des extraits de dessins animés figurant Hitler, des images de soldats nazis, des croix gammées ainsi que des images pornographiques. Des menaces ont également été adressées aux familles.
Par ailleurs, et alors que plusieurs pays commémorent le « Yom HaShoah » (jour dédié au souvenir du génocide des Juifs assassinés lors de la seconde guerre mondiale[3]), une réunion organisée en visioconférence via Zoom lundi 20 avril par l’ambassade d’Israël à Berlin, a été perturbée par des militants antisémites et pro-palestiniens qui ont intercepté le discours d’un survivant de la Shoah, Zvi Herschel, en postant des photos d’Hitler, des images pornographiques et en proférant des slogans agressifs. L'information a été rendue publique par l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Jeremy Issacharoff :
After a short break the event was reconvened without the activists and conducted in an appropriate and respectful way. To dishonour the memory of the #Holocaust and the dignity of the survivor is beyond shame and disgrace and shows the blatant antisemitic nature of the activists. pic.twitter.com/t79gXPYkIO
— Jeremy Issacharoff (@JIssacharoff) April 21, 2020
Ces incidents corroborent ce que nous observons depuis plusieurs années à savoir des formes bruyantes et parfois meurtrières d’antisémitisme dans le monde et notamment dans notre pays[4].
Les commémorations nous font réfléchir aux dilemmes de l’Histoire et de la mémoire, ainsi qu’au rôle des témoins dans la transmission. C’est aux rescapés hagards et silencieux, qui avaient compris qu’ils ne seraient pas compris, que ceux qui témoignent aujourd’hui redonnent une voix. Mais l’enseignement de l’histoire est en principe indépendant de la présence des témoins et mobilise les outils de la rationalité critique. L’éducation civique a elle-même été changée en un enseignement moral et civique. Le Procès de Nuremberg, la création de la notion de « crime contre l’humanité », la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le procès Eichmann ont marqué des tournants décisifs d’une prise de conscience qui commence à l’École. Le slogan « Plus jamais ça ! » repris pour dénoncer le racisme a fini par s’user et son paradoxe est de révéler l’épuisement des pédagogies antiracistes moralisatrices. La condamnation ne peut faire l’économie de la réflexion.
La « culpabilité allemande » a été invoquée par le Président fédéral allemand dans son discours à Jérusalem en janvier dernier lors de la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz, mettant ainsi de côté les analyses qui ont discuté l’idée d’une responsabilité et d’une culpabilité collectives. Ainsi, le philosophe et psychiatre Karl Jaspers, dès 1946, pensait que celui qui est resté passif devant le crime est moralement coupable car il y a toujours du « jeu » pour être actif lorsqu’on est témoin du « malheur même qui frappe la vue »[5].
Les éducateurs et les politiques ont un point en commun : ils recherchent constamment des méthodes et des discours efficaces, mais ils se heurtent à la rémanence de l’antisémitisme, celui-ci ne connaissant que des fluctuations. En effet, l’antisémitisme n’a jamais disparu, il s’est diversifié dans ses sources et justifications idéologiques, s’est métamorphosé au contact des nouveaux médias et des réseaux sociaux. À l’heure où nos institutions soulèvent la question lancinante de la transmission de la mémoire et de l’histoire de la Shoah, ne faut-il pas d’abord s’interroger sur la transmissibilité de l’antisémitisme ? Pourquoi et comment l’antisémitisme se perpétue-t-il d’une génération à l’autre ?
Nous formulons l’hypothèse que cette transmission tient à une forme latente d’antisémitisme présente dans les strates les plus profondes de notre société. Par ailleurs, cette transmissibilité s’observe au sein même d’une certaine jeunesse qui se forge une connivence de groupe et une contre-culture par le rire antisémite comme signe de reconnaissance.
Une enquête réalisée par la Fondapol et publiée en janvier 2020 révèle que l’antisémitisme est un phénomène perçu par les Français de confession ou de culture juive et par le grand public comme étant important et en augmentation. Selon cette étude, 70% de ces Français juifs déclarent avoir été victimes d’au moins un acte antisémite au cours de leur vie.
Ce climat suscite dans la communauté juive un fort sentiment de crainte, voire de peur, qui a pour conséquence des comportements de méfiance et de repli interprétés comme du communautarisme intempestif.
Ainsi, telle étudiante juive résidant à Sarcelles, décrit son quotidien. Afin de se rendre à la synagogue en face de chez elle et se soustraire aux regards, elle évite la rue et fait un détour par un grand terrain vague où elle est sûre de ne croiser personne. Tel autre étudiant de la même ville évoque même le « ghetto obligé » pour se soutenir mutuellement. Telle autre personne encore explique : « À mes enfants, je demande de n’avoir aucun signe extérieur religieux. J’ai trop peur qu’ils se fassent agresser, c’est une vraie angoisse. Vivons bien, vivons "casher" comme on dit ! […] On se sent en danger, on a l’impression que l’on veut nous effacer. Donc il y a une réaction en chaîne et on se cache nous-mêmes. » Des Juifs de France ont peur et se posent avec acuité, mais non sans perplexité, la question d’un départ définitif. N’est-ce pas symptomatique d’un malaise profond de notre démocratie ?
Telle est la réalité quotidienne de certaines familles juives en France. Comment dès lors remédier à ce qui ressemble à une purge massive de nos concitoyens juifs ?
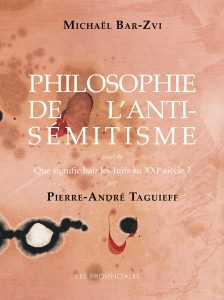
Les symptômes de ce fléau s’observent également sur les murs de la ville, ses portes, ses façades, la « partie commune » de la ville : « Le graffiti devient le complice d’un antisémitisme universel, "partie commune" de la société, quelque chose qui vient d’en bas, du peuple en dessous »[6] . Comme une « blessure irréparable » écrit le philosophe Michaël Bar-Zvi, qui s’expose à hauteur de vue du passant pressé dans la ville, indifférent à la violence rampante qui frappe le corps social malade de ses Juifs.
Le 26 novembre 2019[7], un tag est découvert sur les murs de l’Université Panthéon-Assas qui désigne deux cibles anthropologiques : « à bas le patriarcat » devient « à bas la juiverie » par glissement sémantique et dégradation de la figure d’autorité en une figure d’altérité phobogène.
Ce tag, véritable figure de condensation, au même titre que les rêves, donc surdéterminée et polysémique, greffe un slogan néo-féministe radical inspiré de mai 68 sur une expression de l’inextinguible antisémitisme. « Juiverie » nous renvoie en effet à Édouard Drumont (La France juive) et à l’Affaire Dreyfus, mais aussi au complotisme de l’extrême-droite actuelle. Comme si nous assistions aujourd’hui à la coalescence d’idéologies antagonistes, alors qu’en 68 « à bas le patriarcat ! » aurait plutôt été ponctué par « nous sommes tous des juifs allemands ».
Cette concrétion sémantique, véritable symptôme mural, peut nous porter à une analyse de ce tag surexposé et là encore Bar-Zvi nous éclaire lorsqu’il convoque les représentations de l’antisémite et ce qu’il relève de « l’ethnie putain ». Il cite Alexander Berg : « Toutes le affaires de prostitution et de traite des blanches sont presque exclusivement entre les mains des Juifs »[8] Le mythe, dit Bar-Zvi, associe deux aspects de la prostitution, l’asservissement de la femme et l’« esprit putain ». Dès lors, peut-on faire accroire que ce tag augmenté est une pure coïncidence ?
Il est intéressant de saisir à la racine le sens de ce symptôme. Le patriarcat se rapporte au mythe du père de la horde primitive, jaloux et violent qui garde les femmes et évince les fils et qui se résout par le meurtre du père par les frères expulsés qui le consomment. C’est la thèse de Freud dans Totem et tabou[9] qui stipule que les fils mirent ainsi un terme à la horde paternelle et que de cette manière les choses prirent leur commencement comme les restrictions morales, les organisations sociales et la religion. Après le meurtre, les fils éprouvent regrets et remords, abjurent leurs erreurs et inventent un nouvel ordre social[10]. Ce meurtre ne peut être pensé qu’à la condition où les fils reconnaissent l’image du père et instaurent l’abolition du crime, ce qui suppose l’intériorisation symbolique du meurtre et de sa fonction. Le Juif est la dégradation de ce père castrateur, sa face monstrueuse et perfide, le xenos dit Bar-Zvi, l’étranger qui pervertit le demos, le peuple, en prostituant ses femmes. C’est le père de la horde, bestial dont la soif de pouvoir est inextinguible, et fait échec à la volonté des fils. Le nom même de « juif » est synonyme d’« obscénité ». Ce xenos inquiétant et étranger, qui brave tous les interdits mais en même temps si proche et si familier que cela en devient insupportable, ne relèverait-il pas de la part fantasmatique propre à chacun ? D’où le caractère irrépressible et insurmontable de l’antisémitisme.
Il y a donc toujours des insultes, des graffitis, des menaces ou des rumeurs malveillantes visant « les Juifs ».
À travers ces exemples qui surgissent dans des contextes différents, nous voyons que nous ne sommes plus seulement confrontés à la concurrence des mémoires et au négationnisme, mais aussi, dans les formes les plus récentes et chez les plus jeunes rompus au partage immédiat, à une vulgate antisémite dépolitisée et anhistorique, à peine consciente, encore moins réfléchie. Un antisémitisme sans antisémites, certes, mais un antisémitisme socialisé par le relais des écrans.
Aussi la question des médias doit-elle être appréhendée non seulement sous l’angle des limites et de la réglementation de la liberté d’expression, mais aussi comme le lieu du défi que pose une communauté virtuelle soudée par la transgression jubilatoire de la culture scolaire, académique et de toute culture considérée comme « officielle » en général. Ce qui pose le problème des idéaux que nous pouvons offrir aux nouveaux venus, et donc, de notre capacité à en proposer.
Notes :
[1] Elle est membre d’une synagogue libérale et l'un de ses trois enfants porte une kippa. Après l'incident de mardi, elle a déclaré qu'elle voulait qu'il porte une casquette afin de cacher sa kippa lorsqu’il se promenait dans la rue.
[2] Zoom est un service de téléconférences permettant d’impliquer un grand nombre de participants.
[3] La commémoration se tient généralement le 27 du mois hébraïque de Nissan (entre le début du mois d’avril et celui de mai selon les années) dans le calendrier hébraïque. Cette année elle s’est tenue du lundi 20 avril au soir jusqu’au mardi 21 à 18 heures.
[4] Les chiffres publiés le 27 janvier par le ministère de l’Intérieur indiquent une augmentation de 50% des menaces en 2019 par rapport à 2018 mais une baisse de 15% des actions antisémites en France. Voir également : « Sondage : un Européen sur quatre reconnaît nourrir de l’hostilité à l’égard des Juifs » (29 novembre 2019).
[5] K. Jaspers, La Culpabilité allemande, Editions de Minuit, Paris, 1990.
[6] M. Bar-Zvi, Philosophie de l’antisémitisme, Les Provinciales, Paris, 2019, p. 15.
[7] Remerciements à l’UEJF et Noémie Madar qui nous a communiqué cette photo. Suite à leur action, le tag a été effacé.
[8] Ibid., p.106. Il reprend cette citation du livre antisémite d'Alexander Berg, Juden-Bordelle, Enthüllungen aus dunklen Häusern, 1892 (Les bordels juifs. Révélations sur les maisons closes), tirée du livre de Saul Friedländer. Alexander Berg était un médecin allemand. Une notice de la BNF témoigne de la publication d'ouvrages médicaux et de son titre de docteur.
[9] S. Freud, Totem et tabou. Quelques concordances entre la vie des sauvages et celle des névrosés (1913), Paris, Gallimard, 1993.
[10] Cf. E. Roudinesco, « Freud et le régicide. Eléments d’une réflexion », Revue germanique internationale, 14/2000, p. 113-126. Elle écrit notamment : « Il y aurait donc à l’origine de toute religion et de toute société un acte réel qui ferait événement : un meurtre, un meurtre nécessaire. [...] En conséquence, l’acte réel disparaît au profit de l’acte symbolique. Le meurtre du père devient ainsi une métaphore de la castration et non plus exactement un crime. À cet égard, il y a bien une différence entre Totem et tabou et L’Homme Moïse : dans le premier ouvrage, Freud pose l’existence d’un acte réel, tandis que dans le second, il reconstruit l’origine supposée d’un acte dont nul n’a besoin de savoir s’il a réellement eu lieu, puisque seule compte sa puissance symbolique. »
Les auteurs : Céline Masson est directrice du Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA), Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (CHSSC), Université de Picardie Jules-Verne. Isabelle de Mecquenem est directrice adjointe du RRA, professeure agrégée en INSPE, Université de Reims-Champagne-Ardenne, membre du Conseil des sages de la laïcité. Toutes deux dirigent la collection « Questions sensibles » chez Hermann dont le premier livre, Criminaliser les Juifs de Pierre-André Taguieff, est paru début 2020.
Voir aussi :
La Pologne et la Russie s'accusent mutuellement de falsifier l'histoire
Taguieff : « Une démonologie populaire se forme sous nos yeux sur les réseaux sociaux »
Depuis dix-sept ans, Conspiracy Watch contribue à sensibiliser aux dangers du complotisme en assurant un travail d’information et de veille critique sans équivalent. Pour pérenniser nos activités, le soutien de nos lecteurs est indispensable.