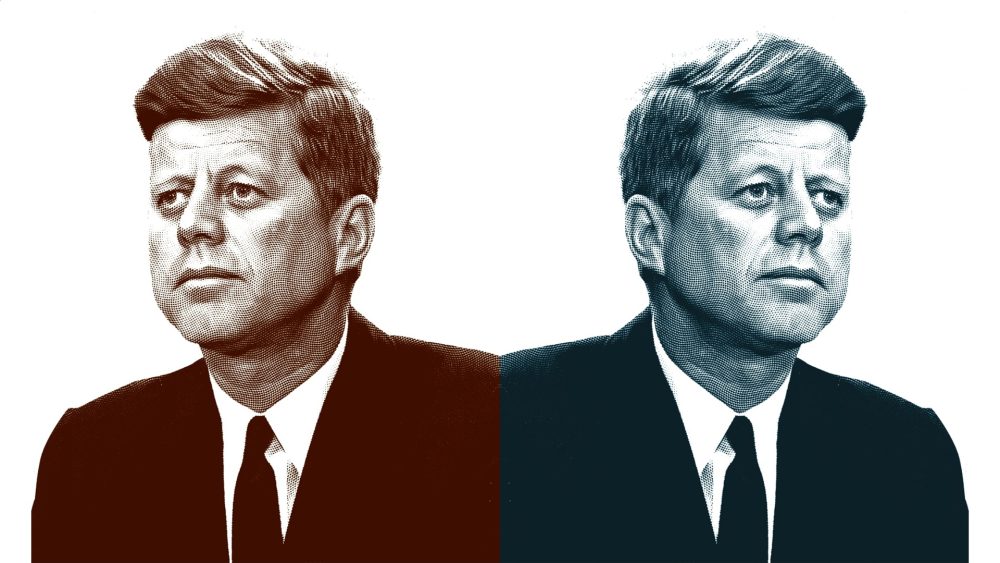
« Le mot même de "secret" est répugnant dans une société libre et ouverte ; en tant que peuple, nous sommes intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. » Cet extrait d'un discours du défunt Président Kennedy prononcé en 1961 est devenu viral ces dernières années. Reproduit quasi-quotidiennement sur les réseaux sociaux, il est souvent exploité pour dénoncer les atteintes portées à la liberté d'expression. À titre d'exemples, le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden l'a repris à son compte sur Twitter en 2019 [archive], de même que Kim Dotcom, le fondateur de Megaupload [archive]. Ou Claire Séverac, en guise de longue épigraphe à son ouvrage Complot mondial contre la santé (2011).
Cependant, la citation a été massivement instrumentalisée par la complosphère pour insinuer, voire prétendre ouvertement, que Kennedy aurait affronté une cabale secrète, ce qui lui aurait coûté la vie le 22 novembre 1963. La nature de cette conspiration varie, bien entendu, selon les obsessions de chaque conspirationniste, des Illuminati (selon Jim Marrs, célèbre théoricien du complot sur l'affaire JFK) au complexe militaro-industriel et la CIA (selon une prétendue maîtresse de Lee Oswald, l'assassin de Kennedy), en passant par « l'État profond », les banques internationales et les extra-terrestres. La mouvance complotiste QAnon en a même fait un de ses mantras, dans le cadre du culte dévoyé qu'elle voue à la dynastie Kennedy.
La complosphère éprouve des difficultés à situer correctement dans le temps le moment où Kennedy a prononcé cette phrase (souvent datée trompeusement de quelques jours avant son assassinat). Une erreur qui n'a rien d'anodin dans la mesure où cette date est essentielle pour saisir le contexte et donc la véritable signification du discours présidentiel.
La citation, en effet, ne correspond nullement à une déclaration de guerre tacite à une quelconque « société secrète » agissant dans l'ombre. Elle est issue d'un discours de Kennedy prononcé le 27 avril 1961 (plus de deux ans avant sa mort) devant l'association américaine des éditeurs de journaux, lequel, tout en faisant mine de dénoncer la culture du secret, vise en fait à convaincre les journalistes américains des bienfaits... de l'auto-censure.
La « conspiration monolithique et impitoyable » à laquelle le président américain fait référence dans son discours est évidemment celle de l'Union soviétique, de ses agents et de ses partisans. De fait, l'allocution de Kennedy intervient alors que les États-Unis viennent d'essuyer coup sur coup deux lourds échecs dans la guerre froide qui les opposent au bloc de l'Est : le 12 avril 1961, un cosmonaute soviétique, Youri Gagarine, a accompli le premier voyage spatial habité par un être humain, au grand dam de la NASA, l'agence spatiale américaine ; cinq jours plus tard, des exilés cubains formés et armés par la CIA ont tenté de débarquer à Cuba, à la Baie des Cochons, pour renverser le régime communiste de Fidel Castro, instauré en 1959. L'opération, approuvée par Kennedy, a tourné à la déconfiture le jour même : non seulement le gouvernement castriste a-t-il tenu bon, démentant les pronostics des Américains (en premier lieu de la CIA), mais encore a-il capturé la majeure partie des assaillants. Fidel Castro, du jour au lendemain, s'est mué en héroïque David contre le Goliath américain, accentuant la coloration romantique qu'il attachait à sa dictature.
Kennedy avait fait son possible, avant le déclenchement de l'invasion, pour camoufler toute responsabilité des États-Unis [1]. Confronté à pareil désastre, et lui-même bouleversé jusqu'aux larmes [2], il n'a d'autre choix que de l'assumer publiquement. Le 20 avril 1961, il s'adresse une première fois à la presse : sans renier l'attaque, qu'il présente comme une croisade pour la liberté, il fait preuve de contrition et affirme vouloir tirer les leçons de l'événement. « La victoire a cent pères, mais la défaite est orpheline », ajoute-t-il le lendemain lors d'une autre conférence de presse. Cette posture, mêlant sens des responsabilités et modestie, est alors saluée par les médias [3], si bien que les sondages lui restent favorables [4].
En privé, Kennedy laisse libre cours à son mécontentement, fustige la CIA (dont il limoge les dirigeants) et reproche à la presse américaine d'avoir contribué au désastre pour avoir révélé les préparatifs de l'invasion avant son lancement. Il est vrai que l'entraînement de formations paramilitaires cubaines anticastristes n'avait pas échappé à l'attention de certains journaux au cours des mois précédents, tels que The Nation ou le New York Times (notamment l'un de ses plus fameux correspondants, Tad Szulc). La Maison Blanche avait même fait pression sur des journalistes pour censurer leurs enquêtes [5].
Au demeurant, Kennedy, lui-même ancien journaliste, ne manquait pas de s'interroger en cette époque de guerre froide sur la conciliation entre liberté de la presse (qui suppose la transparence) et « sécurité nationale » (qui implique le secret). Il avait déjà abordé cette problématique lors de sa première conférence de presse en tant que Président le 25 janvier 1961, appelant à une « décision responsable » des médias aussi bien que de l'exécutif. Du reste, il lui était essentiel de s'assurer du silence de la presse vis-à-vis de ses nombreuses liaisons extraconjugales, qu'il s'acharnait à camoufler avec l'aide de ses conseillers et de ses gardes du corps [6].
Pour autant, le chef de l'exécutif américain ne cherche nullement à s'aliéner les médias, dont il cultive l'amitié pour soigner son image. En conséquence, il exclut catégoriquement d'instaurer un régime de censure d'État, ce que l'URSS ne manquerait pas d'exploiter pour sa propre propagande. Courtisant les dirigeants de la presse, Kennedy espère surtout d'eux qu'ils pratiquent l'auto-censure. La crise de la Baie des Cochons l'incite à clarifier publiquement cette attente. Tel est l'objet de son allocution du 27 avril 1961 devant les éditeurs de journaux, qu'il prononce sur le conseil de son porte-parole, Pierre Salinger [7].
Dans ce discours, Kennedy proclame certes son attachement à la transparence, affichant sa répugnance au « secret ». Mais c'est pour mieux en appeler la presse à s'auto-censurer si la « sécurité nationale » est en jeu. Le monde communiste, assure le Président, se protège grâce au secret et agit dans le secret ; il n'hésite nullement à s'informer sur la défense du « monde libre » en consultant la presse occidentale. Certes, poursuit Kennedy, la guerre froide n'a pas fait l'objet d'une déclaration de guerre, ce qui interdit toute législation d'exception, mais elle n'en existe pas moins, ce qui oblige les médias à prendre leurs « responsabilités ».
Ainsi, le discours du 27 avril 1961, loin de s'opposer à une quelconque conspiration, loin même de s'opposer au « secret » dans cette « société ouverte » qu'est la société américaine, vise à promouvoir le « secret », non point grâce à une loi restreignant la liberté de la presse... mais grâce à la presse elle-même, en comptant sur son sens des « responsabilités », en d'autres termes sa bienveillance, voire sa complicité, vis-à-vis de l'exécutif.
Dans ces conditions, l'allocution du 27 avril 1961 revêt une signification exactement contraire à ce que suggère la citation sur le « secret » qui en est extraite. Elle témoigne, chez Kennedy, d'une tentative de rappeler la presse à l'ordre dans un contexte de crise, alors que sa présidence est humiliée par la défaite de la Baie des Cochons. Bien plus, JFK ne manque pas d'insinuer dans son discours que la débâcle est imputable aux indiscrétions des médias.
Lesdits médias, dans l'ensemble, réagissent vertement à ce coup de semonce, soit pour critiquer cette promotion de l'auto-censure, soit, au contraire, pour reprocher à Kennedy de sous-estimer le patriotisme des journalistes [8]. Le Président et ses conseillers conviendront, en l'occurrence, avoir commis un impair [9], et ils tenteront d'en réparer les dégâts, invitant des patrons de presse à la Maison Blanche pour un rétropédalage. Kennedy ira jusqu'à concéder à Turner Catledge, rédacteur en chef du New York Times : « Peut-être que si vous aviez sorti davantage de papiers sur l'opération [de la Baie des Cochons], vous nous auriez sauvés d'une erreur colossale. » [10]
Toujours est-il que Kennedy, loin d'être un chaleureux partisan de la transparence, continuera de cultiver le secret sous sa présidence. A titre d'exemple, lors de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, il demandera à certains organes de presse de retarder ou de bloquer la parution de leurs articles sur le sujet [11]. Sans parler de sa prédilection pour les « opérations spéciales », censément plus discrètes, aussi bien en Asie du Sud-Est qu'en Amérique latine, lesquelles comprenaient des plans d'assassinat de Fidel Castro [12]. Preuve que le président américain aura, en maintes occasions, surmonté sa « répugnance » à l'encontre du « secret ». Preuve, également, que son discours du 27 avril 1961 ne s'attaquait nullement à une imaginaire conspiration secrète – mais visait à cultiver, maladroitement, le respect des secrets d'État !
DISCOURS DU PRESIDENT JOHN F. KENNEDY DEVANT
L'AMERICAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATION
Hôtel Waldorf-Astoria, New York City
27 avril 1961
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs :
J'apprécie beaucoup votre généreuse invitation à être ici ce soir.
Vous avez de lourdes responsabilités de nos jours et un article que j'ai lu il y a quelque temps m'a rappelé à quel point le poids des événements actuels pèse sur votre profession.
Vous vous souvenez peut-être qu'en 1851, le New York Herald Tribune, parrainé et publié par Horace Greeley, employait comme correspondant à Londres un obscur journaliste du nom de Karl Marx.
On nous dit que le correspondant à l'étranger Marx, fauché, avec une famille malade et sous-alimentée, a constamment fait appel à Greeley et au rédacteur en chef Charles Dana pour une augmentation de son salaire généreux de 5 dollars par tranche, un salaire que lui et Engels ont ingratement qualifié de "tricherie petite-bourgeoise la plus minable".
Mais lorsque tous ses appels financiers ont été refusés, Marx a cherché d'autres moyens de subsistance et de gloire, mettant finalement fin à sa relation avec le Tribune et consacrant ses talents à plein temps à la cause qui léguerait au monde les graines du léninisme, du stalinisme, de la révolution et de la guerre froide.
Si seulement ce journal capitaliste de New York l'avait traité avec plus de gentillesse, si seulement Marx était resté correspondant à l'étranger, l'histoire aurait pu être différente. Et j'espère que tous les éditeurs garderont cette leçon à l'esprit la prochaine fois qu'ils recevront d'un obscur journaliste un appel à la pauvreté pour une petite augmentation de son compte de dépenses.
J'ai choisi comme titre de mon intervention de ce soir "Le président et la presse". Certains pourraient suggérer qu'il serait plus naturel de l'intituler "Le président contre la presse". Mais ce ne sont pas mes sentiments ce soir.
Il est vrai, cependant, que lorsqu'un diplomate bien connu d'un autre pays a récemment exigé que notre département d'État répudie certaines attaques de journaux contre son collègue, il nous a été inutile de répondre que cette administration n'était pas responsable de la presse, car la presse avait déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas responsable de cette administration.
Néanmoins, mon objectif ici ce soir n'est pas de lancer l'attaque habituelle contre la presse dite à parti unique. Au contraire, ces derniers mois, j'ai rarement entendu des plaintes concernant le parti pris politique de la presse, sauf de la part de quelques républicains. Mon but ce soir n'est pas non plus de discuter ou de défendre la télédiffusion des conférences de presse présidentielles. Je pense qu'il est très utile que quelque 20 millions d'Américains assistent régulièrement à ces conférences pour observer, si je puis dire, les qualités incisives, intelligentes et courtoises dont font preuve vos correspondants à Washington.
Enfin, ces remarques n'ont pas non plus pour but d'examiner le degré approprié de confidentialité que la presse devrait accorder à tout président et à sa famille.
Si, au cours des derniers mois, vos reporters et photographes de la Maison Blanche ont assisté régulièrement à des services religieux, cela ne leur a certainement fait aucun mal.
D'un autre côté, je me rends compte que votre personnel et les photographes des agences de presse se plaignent peut-être de ne plus bénéficier des mêmes privilèges sur les terrains de golf locaux qu'auparavant.
Il est vrai que mon prédécesseur n'avait pas les mêmes objections que moi à l'égard des photos de ses talents de golfeur en action. Mais d'un autre côté, il n'a jamais non plus harcelé un homme des services secrets.
Le sujet que je vais aborder ce soir est plus sobre et concerne aussi bien les éditeurs que les rédacteurs.
Je veux parler de nos responsabilités communes face à un danger commun. Les événements de ces dernières semaines ont peut-être contribué à mettre en lumière ce défi pour certains, mais les dimensions de cette menace se profilent à l'horizon depuis de nombreuses années. Quels que soient nos espoirs pour l'avenir, qu'il s'agisse de réduire cette menace ou de s'en accommoder, on ne peut échapper ni à la gravité ni à la totalité du défi qu'elle représente pour notre survie et notre sécurité, un défi auquel nous sommes confrontés de manière inhabituelle dans toutes les sphères de l'activité humaine.
Ce défi mortel impose à notre société deux exigences qui concernent directement la presse et le président - deux exigences qui peuvent sembler presque contradictoires, mais qui doivent être conciliées et remplies si nous voulons faire face à ce péril national. Je me réfère, premièrement, à la nécessité d'une information publique beaucoup plus grande ; et, deuxièmement, à la nécessité d'un secret officiel beaucoup plus grand.
I
Le mot même de "secret" est répugnant dans une société libre et ouverte ; en tant que peuple, nous sommes intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. Nous avons décidé il y a longtemps que les dangers d'une dissimulation excessive et injustifiée de faits pertinents l'emportaient de loin sur les dangers invoqués pour la justifier. Aujourd'hui encore, il est peu utile de s'opposer à la menace d'une société fermée en imitant ses restrictions arbitraires. Même aujourd'hui, il est peu utile d'assurer la survie de notre nation si nos traditions ne survivent pas avec elle. Et il y a un très grave danger qu'un besoin annoncé de sécurité accrue soit saisi par ceux qui sont désireux d'en étendre le sens jusqu'aux limites de la censure et de la dissimulation officielles. Je n'ai pas l'intention de permettre cela dans la mesure où je peux le contrôler. Et aucun fonctionnaire de mon administration, qu'il soit de haut ou de bas rang, civil ou militaire, ne devrait interpréter mes paroles ici ce soir comme une excuse pour censurer les nouvelles, pour étouffer la dissidence, pour dissimuler nos erreurs ou pour cacher à la presse et au public les faits qu'ils méritent de connaître.
Mais je demande à chaque éditeur, à chaque rédacteur en chef et à chaque journaliste de la nation de réexaminer ses propres normes et de reconnaître la nature du péril que court notre pays. En temps de guerre, le gouvernement et la presse ont l'habitude de s'unir dans un effort basé en grande partie sur l'autodiscipline, afin d'empêcher les divulgations non autorisées à l'ennemi. En cas de "danger clair et présent", les tribunaux ont jugé que même les droits privilégiés du premier amendement devaient céder devant le besoin de sécurité nationale du public.
Aujourd'hui, aucune guerre n'a été déclarée - et aussi féroce que soit la lutte, elle ne sera peut-être jamais déclarée de manière traditionnelle. Notre mode de vie est attaqué. Ceux qui se font nos ennemis avancent dans le monde entier. La survie de nos amis est en danger. Et pourtant, aucune guerre n'a été déclarée, aucune frontière n'a été franchie par des troupes en marche, aucun missile n'a été tiré.
Si la presse attend une déclaration de guerre avant d'imposer l'autodiscipline des conditions de combat, alors je peux seulement dire qu'aucune guerre n'a jamais représenté une plus grande menace pour notre sécurité. Si vous attendez la conclusion d'un "danger clair et présent", je peux seulement dire que le danger n'a jamais été aussi clair et que sa présence n'a jamais été aussi imminente.
Il exige un changement de perspective, un changement de tactique, un changement de mission - par le gouvernement, par le peuple, par chaque homme d'affaires ou dirigeant syndical, et par chaque journal. Car nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui s'appuie principalement sur des moyens clandestins pour étendre sa sphère d'influence - sur l'infiltration au lieu de l'invasion, sur la subversion au lieu des élections, sur l'intimidation au lieu du libre choix, sur les guérillas de nuit au lieu des armées de jour. Il s'agit d'un système qui a mobilisé d'énormes ressources humaines et matérielles pour construire une machine très efficace, étroitement soudée, qui combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, économiques, scientifiques et politiques.
Ses préparatifs sont dissimulés, pas publiés. Ses erreurs sont enterrées, pas titrées. Ses dissidents sont réduits au silence et non loués. Aucune dépense n'est remise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. Elle mène la guerre froide, en bref, avec une discipline de guerre qu'aucune démocratie ne pourrait espérer ou souhaiter égaler.
Néanmoins, toute démocratie reconnaît les contraintes nécessaires à la sécurité nationale - et la question demeure de savoir si ces contraintes doivent être plus strictement observées si nous voulons nous opposer à ce type d'attaque ainsi qu'à une invasion pure et simple.
Car les faits sont les suivants : les ennemis de cette nation se sont ouvertement vantés d'avoir obtenu par nos journaux des informations qu'ils auraient autrement engagé des agents pour obtenir par le vol, la corruption ou l'espionnage ; les détails des préparatifs secrets de cette nation pour contrer les opérations secrètes de l'ennemi ont été mis à la disposition de tous les lecteurs de journaux, amis et ennemis confondus ; que la taille, la force, l'emplacement et la nature de nos forces et de nos armes, ainsi que nos plans et notre stratégie pour les utiliser, ont tous été indiqués dans la presse et dans d'autres médias d'information à un degré suffisant pour satisfaire n'importe quelle puissance étrangère ; et que, dans un cas au moins, la publication de détails concernant un mécanisme secret permettant de suivre les satellites a nécessité sa modification au prix d'un temps et d'un argent considérables.
Les journaux qui ont imprimé ces histoires étaient loyaux, patriotiques, responsables et bien intentionnés. Si nous avions été engagés dans une guerre ouverte, ils n'auraient sans doute pas publié de tels articles. Mais en l'absence de guerre ouverte, ils n'ont reconnu que les tests du journalisme et non ceux de la sécurité nationale. Et ma question ce soir est de savoir si des tests supplémentaires ne devraient pas être adoptés maintenant.
C'est à vous seuls de répondre à cette question. Aucun fonctionnaire ne devrait y répondre à votre place. Aucun plan gouvernemental ne devrait imposer ses restrictions contre votre volonté. Mais je manquerais à mon devoir envers la nation, compte tenu de toutes les responsabilités qui sont les nôtres et de tous les moyens dont nous disposons pour les assumer, si je ne soumettais pas ce problème à votre attention et si je ne vous demandais pas d'y réfléchir.
En de nombreuses occasions, j'ai dit - et vos journaux l'ont constamment répété - que ces temps font appel au sens du sacrifice et à l'autodiscipline de chaque citoyen. Ils demandent à chaque citoyen de peser ses droits et son confort contre ses obligations envers le bien commun. Je ne peux pas croire maintenant que les citoyens qui travaillent dans le secteur de la presse se considèrent comme exempts de cet appel.
Je n'ai pas l'intention de créer un nouveau Bureau d'information sur la guerre pour régir le flux des nouvelles. Je ne suggère aucune nouvelle forme de censure ni aucun nouveau type de classification de sécurité. Je n'ai pas de réponse facile au dilemme que j'ai posé, et je ne chercherais pas à l'imposer si j'en avais une. Mais je demande aux membres de la profession de journaliste et de l'industrie de ce pays de réexaminer leurs propres responsabilités, de considérer le degré et la nature du danger actuel, et de tenir compte du devoir de retenue que ce danger nous impose à tous.
Chaque journal se demande maintenant, à propos de chaque article : "Est-ce une nouvelle ?" Tout ce que je suggère, c'est d'ajouter la question suivante : "Est-ce dans l'intérêt de la sécurité nationale ?" Et j'espère que tous les groupes en Amérique - syndicats, hommes d'affaires et fonctionnaires à tous les niveaux - poseront la même question à leurs entreprises, et soumettront leurs actions aux mêmes tests rigoureux.
Et si la presse américaine envisage et recommande la prise en charge volontaire de nouvelles mesures ou de nouveaux mécanismes spécifiques, je peux vous assurer que nous coopérerons de tout cœur avec ces recommandations.
Peut-être n'y aura-t-il pas de recommandations. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse au dilemme auquel est confrontée une société libre et ouverte dans une guerre froide et secrète. En temps de paix, toute discussion sur ce sujet, et toute action qui en découle, sont à la fois douloureuses et sans précédent. Mais nous vivons une période de paix et de péril qui ne connaît pas de précédent dans l'histoire.
II
C'est la nature sans précédent de ce défi qui donne également lieu à votre deuxième obligation - une obligation que je partage. Il s'agit de notre obligation d'informer et d'alerter le peuple américain - de nous assurer qu'il possède tous les faits dont il a besoin et qu'il les comprend également - les périls, les perspectives, les objectifs de notre programme et les choix auxquels nous sommes confrontés.
Aucun président ne devrait craindre l'examen public de son programme. Car de cet examen découle la compréhension, et de cette compréhension découle le soutien ou l'opposition. Et les deux sont nécessaires. Je ne demande pas à vos journaux de soutenir l'administration, mais je sollicite votre aide dans l'immense tâche d'informer et d'alerter le peuple américain. Car j'ai une confiance totale dans la réponse et le dévouement de nos citoyens lorsqu'ils sont pleinement informés.
Non seulement je n'ai pas voulu étouffer la controverse parmi vos lecteurs, mais je l'ai accueillie favorablement. Cette administration a l'intention d'être franche à propos de ses erreurs ; car comme un homme sage l'a dit un jour : "Une erreur ne devient pas une faute tant que vous ne refusez pas de la corriger". Nous avons l'intention d'accepter l'entière responsabilité de nos erreurs ; et nous attendons de vous que vous les signaliez lorsque nous les manquons.
Sans débat, sans critique, aucune administration ni aucun pays ne peut réussir - et aucune république ne peut survivre. C'est pourquoi le législateur athénien Solon a décrété qu'il était criminel pour tout citoyen de fuir la controverse. Et c'est pourquoi notre presse a été protégée par le premier amendement - la seule activité en Amérique spécifiquement protégée par la Constitution - non pas pour amuser et divertir, non pas pour mettre l'accent sur le trivial et le sentimental, non pas pour simplement "donner au public ce qu'il veut" - mais pour informer, éveiller, réfléchir, exposer nos dangers et nos opportunités, indiquer nos crises et nos choix, diriger, modeler, éduquer et parfois même irriter l'opinion publique.
Cela signifie une plus grande couverture et analyse des nouvelles internationales - car elles ne sont plus lointaines et étrangères mais proches et locales. Cela signifie qu'il faut accorder une plus grande attention à l'amélioration de la compréhension des nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leur transmission. Enfin, cela signifie que le gouvernement, à tous les niveaux, doit remplir son obligation de vous fournir l'information la plus complète possible en dehors des limites les plus étroites de la sécurité nationale - et nous avons l'intention de le faire.
III
C'est au début du XVIIe siècle que Francis Bacon a fait remarquer que trois inventions récentes transformaient déjà le monde : la boussole, la poudre à canon et la presse à imprimer. Aujourd'hui, les liens entre les nations forgés par la boussole ont fait de nous tous des citoyens du monde, les espoirs et les menaces de l'un devenant les espoirs et les menaces de tous. Dans les efforts de ce seul monde pour vivre ensemble, l'évolution de la poudre à canon jusqu'à sa limite ultime a averti l'humanité des terribles conséquences d'un échec.
Et c'est donc vers la presse à imprimer - vers l'enregistreur des actes de l'homme, le gardien de sa conscience, le messager de ses nouvelles - que nous nous tournons pour trouver force et assistance, confiants qu'avec votre aide l'homme sera ce qu'il est né pour être : libre et indépendant.
Notes :
[1] Robert Dallek, Camelot's Court. Inside the Kennedy White House, New York, HarperCollins, 2013, p. 136-141.
[2] Robert Dallek, An Unfinished Life. John F. Kennedy. 1917-1963, Boston, Little, Brown & Company, 2003, p. 366.
[3] Thomas W. Benson, Writing JFK. Presidential rhetoric and the press in the Bay of Pigs crisis, College Station, Texas A & M University Press, 2004 p. 35-42.
[4] Un sondage réalisé le 5 mai 1961 par Gallup/American Institute of Public Opinion révèle que 61 % des personnes interrogées approuvent la gestion de la crise cubaine par Kennedy. Voir Hazel Gaudet Erskine, "The Polls: Kennedy as President", The Public Opinion Quarterly, vol. 28, n°2, 1964, p. 338.
[5] Arthur M. Schlesinger, A Thousand Days. John F. Kennedy in the White House, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 1965, rééd. : 2002, p. 272 et 300-301.
[6] Michael O'Brien, John F. Kennedy’s Women. The Story of a Sexual Obsession, Now and Then Reader, 2011.
[7] Pierre Salinger, With Kennedy, New York Doubleday, 1966, p. 155-158.
[8] Ibid., p. 157-158 ainsi que Benson, Writing JFK, op. cit., p. 67-71.
[9] Voir, outre Salinger, op. cit., les mémoires d'un autre conseiller de JFK, Ted Sorensen (qui a rédigé les plus célèbres discours du Président), Counselor. A life at the edge of History, New York, HarperCollins, 2008, 235-236.
[10] Harrison E. Salisbury, Without Fear Or Favor. The New York Times and its times, New York, Ballantine, 1980, p. 155.
[11] Serhii Plokhy, Nuclear Folly. A New History of the Cuban Missile Crisis, New York, W. W. Norton and Company, 2021, p. 193-194.
[12] Voir sur ce point Lawrence Freedman, Kennedy's Wars: Berlin, Cuba, Laos, and Vietnam, Oxford/New York, Oxford University Press, 2000. Lucien S. Vandenbroucke, dans Perilous Options. Special Operations as an Instrument of US Foreign Policy, New York/Oxford, Oxford University Press, 1993, montre bien que les successeurs de Kennedy reprendront à leur compte cette stratégie des "opérations spéciales".
Voir aussi :
(Dernière mise à jour le 11/08/2023)
Depuis dix-sept ans, Conspiracy Watch contribue à sensibiliser aux dangers du complotisme en assurant un travail d’information et de veille critique sans équivalent. Pour pérenniser nos activités, le soutien de nos lecteurs est indispensable.